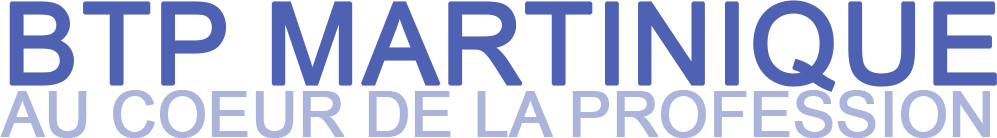Le Code du travail fait des délégués du personnel les véritables gardiens des droits et libertés dans l’entreprise. Aussi leur octroie-t-il un droit d’alerte mobilisable dès lors que, dans l’entreprise, ils constatent une atteinte injustifiée « aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles ». Voilà pour la théorie car, en pratique, ce droit d’alerte n’est pour ainsi dire jamais mis en œuvre. Et force est de constater que la position que la Cour de cassation adopte en la matière n’est pas franchement de nature à faire bouger les lignes. Cass. soc. 09.02.2016, n° 14-18.567
Le cadre légal
Le Code du travail, pris en son article L. 2313-2, précise que les délégués du personnel ont la faculté de saisir l’employeur dès lors qu’ils constatent qu’ « il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ».
En droit, l’alerte ainsi remontée est de nature à avoir deux effets :
- Une obligation pour l’employeur, avec le délégué du personnel auteur de la requête, de diligenter une enquête et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation ;
- En cas de carence de l’employeur à diligenter l’enquête, ou en cas de conclusions contradictoires entre l’employeur et le délégué du personnel, une possibilité pour ce dernier (dès lors que le salarié « victime » ne s’y oppose pas) de saisir le conseil de prud’hommes afin qu’il puisse rapidement être ordonné « toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ».
Mais pour qu’une telle procédure puisse être valablement impulsée, encore faut-il que certaines conditions soient réunies. Et c’est bien ce que l’arrêt ici commenté vient rappeler.
Les faits
En l’espèce, une salariée de l’entreprise, par ailleurs représentante du personnel, s’était vu reprocher d’avoir tenu des propos déplacés alors que, dans le cadre de l’exercice de son mandat, elle visitait l’une des agences de l’entreprise. Propos qui, à l’évidence, n’étaient en rien rattachables à l’exercice de ses fonctions de représentation.
Des conditions de mise en œuvre du droit d’alerte qui n’étaient pas réunies
Dans la foulée de ces agissements considérés par l’employeur comme fautifs, la salariée concernée avait été convoquée à un entretien préalable avant d’être finalement sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire. Par la suite, elle avait visiblement eu à connaître d’une altération de sa santé.
Estimant être en présence d’une atteinte à la « santé physique et mentale » d’une salariée de l’entreprise au sens de l’article L. 2313-2 du Code du travail, un délégué du personnel de l’entreprise décida de saisir l’employeur afin que, en interne, une enquête soit le plus rapidement possible diligentée.
Mais il a fait face au refus de l’employeur pour qui les conditions de mise en œuvre du droit d’alerte n’étaient nullement réunies puisque, toujours selon lui, « aucune atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ou toute autre mesure discriminatoire relative notamment au mandat de la salariée n’était établie ».
Position patronale validée par la cour d’appel puis par la Cour de cassation qui concède ainsi à ce dernier « le pouvoir de se faire juge, a priori, du bien-fondé ou du mal fondé de l’alerte » et donc de refuser de lui donner suite.
Le sens de ces décisions pourrait bien altérer l’effectivité d’un droit d’alerte des délégués du personnel déjà bien peu vivace puisqu’elle permet à un employeur de refuser de diligenter une enquête et/ou d’ordonner « toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte » en arguant, simplement, que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 2313-2 du Code du travail ne sont pas réunies. Confronté à une telle obstruction, le délégué du personnel ayant initié la procédure d’alerte n’aura d’autre choix que de saisir, en urgence, le juge prud’homal afin que ce dernier apprécie la situation et décide si, oui ou non, l’employeur aurait dû donner suite.
Mais le temps d’en arriver là, bien des jours risqueront d’être perdus et il se pourrait bien que la situation, dès lors qu’elle revêt un caractère d’urgence particulièrement aigu, ne puisse être convenablement traitée. Il eut donc été, sans conteste, plus adapté et plus protecteur (pour les salariés) que, au moins en ce qui concerne la mise en œuvre de l’enquête interne, le contrôle du juge fût envisagé a posteriori et non a priori. L’employeur eut alors été contraint de donner suite, ou moins partiellement, au droit d’alerte du délégué de personnel. Ce qui ne l’aurait nullement empêché de saisir le juge afin de contester l’utilité et donc la pérennité de l’enquête.
Ce n’est malheureusement pas l’option que la Cour de cassation retient.
Les sanctions disciplinaires hors champ des « mesures » que le juge peut prendre
Par-delà les circonstances qui sont censées permettre (ou non) le déclenchement du droit d’alerte, cette affaire était aussi porteuse d’une autre question. Celle de savoir si un délégué du personnel, dès lors que son action est considérée comme légitime, a (ou non), par ce biais, le droit de solliciter l’annulation d’une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur ?
Le texte constitutif du droit d’alerte précise, en effet, que « le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ». Or, ici, le délégué du personnel estimait que c’était bel et bien le prononcé (qu’il considérait comme abusif) d’une sanction disciplinaire (en l’occurrence, une mise à pied) qui devait être considéré comme constitutif de l’atteinte. Aussi demandait-il l’annulation de la sanction. Et pour ce faire, il se référait au caractère a priori très extensif du pouvoir ici conféré au juge : « Le juge peut ordonner toute mesure ». Il n’était, en effet, pas tout à fait insensé d’imaginer que la formulation « toute mesure » était potentiellement de nature à intégrer celle consistant à annuler les sanctions disciplinaires.
Tel n’était pas la position de l’employeur qui, à ce propos, était venu rappeler que le contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires était régi par des textes propres (1) qu’il appartenait à la salariée de mobiliser dès lors qu’elle estimerait que sa sanction était « infondée, irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise ».
Aussi, pour l’employeur, autoriser le délégué du personnel d’user du droit d’alerte à cette fin serait revenu à lui permettre de le détourner de son objet.
Position patronale suivie et par la cour d’appel et par la Cour de cassation qui, par un attendu de portée générale, considère que « l’exercice du droit d’alerte conféré aux délégués du personnel ne saurait avoir pour objet de faire annuler une sanction disciplinaire pour laquelle le salarié dispose d’une voie de recours spécifique ».
Clairement donc, l’exercice du droit disciplinaire ne saurait être contrôlé par l’entremise du droit d’alerte. L’appréciation de la Cour de cassation peut certes s’entendre, mais force est de constater que le principe général qu’elle pose n’est pas sans faire fi de la situation dans laquelle un employeur aurait usé de son pouvoir de sanction afin de sciemment « porter atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles ».
On peut donc regretter que, dans un tel cas de figure, l’annulation de sanctions disciplinaires, elles-mêmes détournées de leur objet, ne puisse être envisagée dans le cadre la procédure spécifique au droit d’alerte. Fort opportunément, cela n’aurait pu que contribuer à lui redonner quelques couleurs.
(1) cf. art. L. 1333-1 à L. 1333-3 C. trav.
Source : Service juridique de la CFDT