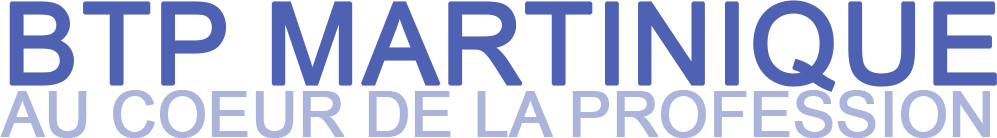Les périodes de changement sont aussi des périodes de production d’utopies. Cela se comprend. On sait ce que l’on quitte. On sait ce dont on ne veut plus. Mais on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Et donc on l’imagine, souvent par réaction à ce que l’on rejette pour des raisons morales. Le XVIIIème et le XIXème siècle furent ainsi jalonnés d’utopies sociales. Ces utopies opposaient à la dure réalité l’image d’un monde qui se voulait meilleur. On parla ainsi, avec Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier et d’autres, de « socialisme utopique ».
Les utopies se veulent, à partir des valeurs, souvent généreuses, qui animent leur auteur, une description des choses telles quelles devraient être. L’histoire avance au fil des utopies. Celles-ci, toutefois, se réalisent rarement. La réalité leur résiste. Et le réalisme conduit à des compromis entre ce qui est considéré comme souhaitable et ce qui est finalement possible. L’imagination et l’enthousiasme laissent place alors, parfois au compromis, parfois à d’amères déceptions.
Cela est vrai dans le domaine qui nous occupe, c’est à dire celui de l’organisation et du management humain de l’entreprise. On retiendra ici trois utopies managériales. Toutes trois sont l’objet de débats passionnés, lors desquels s’affrontent partisans sûrs de leur fait, opposants résolus et sceptiques soucieux de ne pas perdre de vue la réalité.
Utopie n°1 : l’entreprise libérée
L’entreprise libérée fait aujourd’hui partie des « musts » du discours managérial et constitue le fond de commerce de son « inventeur », Isaac Getz, professeur à l’ESCP et auteur d’un livre à succès sur ce thème.
Le principe de l’entreprise libérée est simple. Il faut en finir avec l’organisation hiérarchique, les reportings, les contrôles, les procédures, les autorisations, bref avec tout ce qui vient entraver la créativité et l’efficacité de l’homme au travail. Il faut donc lui faire confiance et laisser faire au mieux celui qui sait. Il en résultera une meilleure coopération entre les uns et les autres, davantage de liberté et de possibilités d’épanouissement pour chacun, et finalement (ou tout d’abord) davantage d’efficacité pour l’entreprise.
On comprend bien ce à quoi entendent mettre fin les partisans de l’entreprise libérée et l’on ne peut, avec eux, que critiquer la lourdeur organisationnelle qui caractérise nombre de très grandes entreprises. Reste à savoir s’il suffit de supprimer contrôles et reporting pour que, spontanément, chacun puisse améliorer son efficacité. Celle-ci, ne reposant plus sur la contrainte, doit reposer sur sa libre contribution à l’action menée en commun. Certes, l’homme s’intéresse à ce qu’il fait et au produit de son action, mais cela suffit-il ? Il est permis d’en douter. Vont survenir quantité de causes de zizanie que nulle autorité ne viendra plus arbitrer. Et, à l’absence de hiérarchie visible et officielle, répondant à certains critères de compétence, risquent de substituer des hiérarchies officieuses qui ne garantiront ni l’efficacité collective ni l’équité entre les membres du collectif.
L’entreprise libérée repose ainsi sur ce qui était déjà la conviction de Jean-Jacques Rousseau : l’homme est naturellement bon dès lors qu’on en a fini avec les institutions qui l’entravent. Isaac Getz cherche ainsi à promouvoir une sorte de retour à l’état de nature dans des termes qui ne sont pas sans rappeler l’utopie marxienne sur le communisme réalisé, chacun vacant librement aux occupations de son choix, comme l’imaginaient Boukharine et Preobrajinsky dans leur ABC du communisme.
Pourtant, ce n’est pas ainsi que les chose se passent et on ne sera pas étonné de constater que l’entreprise libérée ne concerne aujourd’hui qu’un petit nombre d’entreprises, généralement de taille modeste, parfois avec succès, mais pas toujours, et généralement pas dans les conditions dont font état les médias. A cela s’ajoute que l’entreprise libérée n’est pas vraiment chose nouvelle si l’on prend en considération le mouvement des équipes autonomes, des cercles de qualité, de la DPPO, et même des groupes d’expression des salariés qui, dans le milieu des années quatre-vingt du siècle dernier, devaient révolutionner l’entreprise et mettre fin au taylorisme. Et donc, l’entreprise libérée est à consommer avec prudence et modération en se gardant, en voulant à juste titre faire « avancer les choses », de tout irréalisme et de tout triomphalisme prématuré. Les choses sont plus compliquées qu’elles ne paraissent à la lecture de Liberté &Cie.
Utopie n°2 : l’entreprise digitale
Le progrès technique, depuis le XIXème siècle et le développement de l’idéologie du progrès, a donné naissance à une très riche floraison d’utopies. Les romans et les films de science fiction en donnent un aperçu : robots humanoïdes, vaisseaux spatiaux, villes souterraines ou aériennes, colonisation d’autres planètes et ainsi de suite. D’une façon générale, l’idéologie du progrès nous présente l’avenir comme devant être nécessairement meilleur, et ce par le simple effet de la mise en œuvre de technologies nouvelles. Rares sont les œuvres de fictions, comme celles de Paolo Bacigalupi, qui en montrent les dangers. Et donc, il va de soi que l’idéologie du progrès technologique, telle qu’elle a été dénoncée par Jacques Ellul, concerne directement l’entreprise.
L’introduction des ordinateurs dans les entreprises remonte à une quarantaine d’années. Ils allaient tout changer. On en vint ainsi à parler de « l’entreprise sans papier ». Puis vinrent Internet, les réseaux sociaux et, tout récemment, les « big data ». Et de nouveau, le discours dominant annonce que cela va tout changer : l’organisation, la nature des emplois, et ainsi de suite. Le salut de l’entreprise passerait par sa « digitalisation » et elle y serait de toutes façons obligée par la concurrence. Prétendre apporter des nuances à ce discours optimiste conduit au risque d’être accusé d’obscurantisme, donc de tenir un discours dépourvu de toute pertinence.
Certes, il ne s’agit pas de nier tous les avantages qu’offre la possibilité de communiquer par e-mails, de chercher une information sur Wikipedia ou de se faire livrer à domicile après avoir passé commande sur Internet. La vraie question n’est pas celle-là. Il s’agit de savoir si le progrès humain se confond avec l’informatisation intégrale et si les effets de celle-ci correspondent vraiment à ce qui en est attendu.
Or, on observera ceci : conformément aux présupposés de l’idéologie du progrès technique, les effets de la digitalisation sont envisagés d’une manière systématiquement positive. Les effets négatifs, ou tout simplement alternatifs par rapport à ce qui en était attendu, ne sont pratiquement jamais évoqués, ou alors de façon fugitive et anecdotique. Cela se comprend : les experts qui sont à l’origine de la mise en place de « l’architecture informatique » de l’entreprise croient dans leur projet, ils savent qu’ils seront jugés sur les résultats et ils ne vont évidemment pas faire état, quand il y en a, des dysfonctionnements qui s’ensuivent. Ils ne sont en outre pas nécessairement bien informés de la façon dont le système est perçu à l’intérieur du corps social. En outre, et peut-être même surtout, ils agissent sous couvert des prestataires de services informatiques.
Il est ainsi frappant de constater à quel point le discours sur « l’entreprise digitale » et, depuis peu, les « big data », est produit par les fournisseurs de « solutions informatiques », hier IBM, aujourd’hui Google et les SSII. L’intérêt de Google et des SSII est bien évidemment de vanter les mérites de leurs « solutions ». De là un effet de saturation tel qu’il a cessé d’être visible. Or, il est rare qu’une prise de position ou un témoignage en faveur de « l’entreprise digitale » ne soit pas le produit, direct ou indirect, d’un discours commercial intéressé.
A cela s’ajoute un autre point : l’utilisation faite d’Internet, de l’Intranet maison ou des réseaux sociaux ne correspond pas nécessairement aux espoirs de leurs promoteurs. Et l’on verra ainsi l’utilisation effective d’un coûteux Intranet se limiter à deux « communautés de métier » (si l’on peut dire) : l’amicale des Bretons et le club des philatélistes. Ou encore, le jeune ingénieur demandera conseil à son copain de promotion travaillant dans l’entreprise concurrente plutôt qu’à ses propres collègues. Et pour finir, on soulignera que l’architecture informatique de l’entreprise peut conduire à une extraordinaire centralisation, au développement d’une bureaucratie informatique tatillonne, impersonnelle et lointaine, et donc à une dépossession des acteurs locaux de leurs marges d’initiative face aux problèmes qu’ils rencontrent.
L’entreprise digitale, donc, est à classer au nombre des utopies. Elle contribue à structurer la pensée politiquement correcte et les projets entrepreneuriaux, mais conduira à des résultats nécessairement différents, et sans doute moins spectaculaires et enthousiasmants que ce qui en est attendu.
Utopie n°3 : le travail autonome
L’utopie se construit par opposition à ce que l’on rejette. Nombre de nos contemporains rejettent aujourd’hui les effets du lien de subordination tel qu’il résulte du travail salarié sous la forme qu’il a pris durant la révolution industrielle. Ils ont le sentiment de « perdre leur vie à la gagner », de subir des prescriptions absurdes qui les empêchent de pratiquer correctement leur métier, ou encore, de subir le risque de perdre leur emploi qu’elle que soient par ailleurs leurs compétences. Il en résulte que nombre de jeunes – et de moins jeunes – veulent échapper à un statut qui, à leurs yeux, présente surtout des inconvénients ; ils veulent reprendre leur liberté et conduire leur existence professionnelle à leur guise. Bien sûr, ensuite, il y a ceux qui le font et ceux qui se contentent d’en rêver.
Il n’en fallait pas plus pour que certains analystes en viennent à estimer que le travail salarié va disparaître et que l’activité professionnelle se présentera demain sous la forme du travail salarié. C’est oublier que les changements sociaux de grande ampleur sont lents. Le travail salarié a mis un siècle à s’imposer comme la forme juridique dominante du travail; encore a-t-il laissé place à des formes antérieures : travailleurs indépendants, agriculteurs, commerçants, membres d’une profession à statut, et ainsi de suite. Autrement dit, si la forme statutaire du travail aujourd’hui dominante se trouve bousculée, ce n’est pas pour autant qu’elle disparaîtra nécessairement.
A cette illusion s’oppose en tout cas le point de vue de ceux des observateurs qui pointent le fait que dans les statistiques le travail indépendant n’ait pratiquement pas progressé depuis dix ans. C’est là, cependant, céder à une autre illusion. Sur son étal au marché de Saint Jean, la jeune femme qui me vend de la viande emballée sous vide débitée et préparée par son mari dans la ferme où ils élèvent leurs veaux, et que l’on peut déguster sur place quand ils font table d’hôte, éventuellement avec l’organisation de soirées musicales, est-elle commerçante, bouchère, agricultrice, restauratrice ou organisatrice de spectacles. ? Précisons que ce n’est pas sur son site Internet que l’on trouvera la réponse et celle-ci, quelle qu’elle soit, sera nécessairement réductionniste. Autrement dit, les critères statistiques sont des boîtes conçues artificiellement et qui accueillent difficilement des réalités économiques et sociales changeantes et multiformes. Or, comme l’affirmait déjà St Thomas d’Aquin, il ne faut pas confondre les distinctions liés à la nature des choses avec celles qui résultent de notre manière de les comprendre.
Le travail autonome, autrement dit, est porteur d’espoir pour ceux qui se tournent vers lui et se comprend par ailleurs comme un produit du changement technique et de l’organisation industrielle. Tout le monde n’a pas une vocation de hacker ; et parmi les hackers, il y a ceux qui le restent mais également ceux qui en sortent à la tête d’un empire industriel, tels Steve Jobs ou Bill Gates. Et enfin il y a également ceux et celles qui se tournent vers le travail autonome faute de trouver un emploi salarié et les travailleurs autonomes derrière lesquels se profile des plateformes technologiques et capitalistes qui relèvent rien moins que du travail autonome. Le constat d’une tendance, souhaitable ou regrettable, ne doit pas se confondre avec l’illusion d’un nouveau one best way.
Par Hubert LANDIER